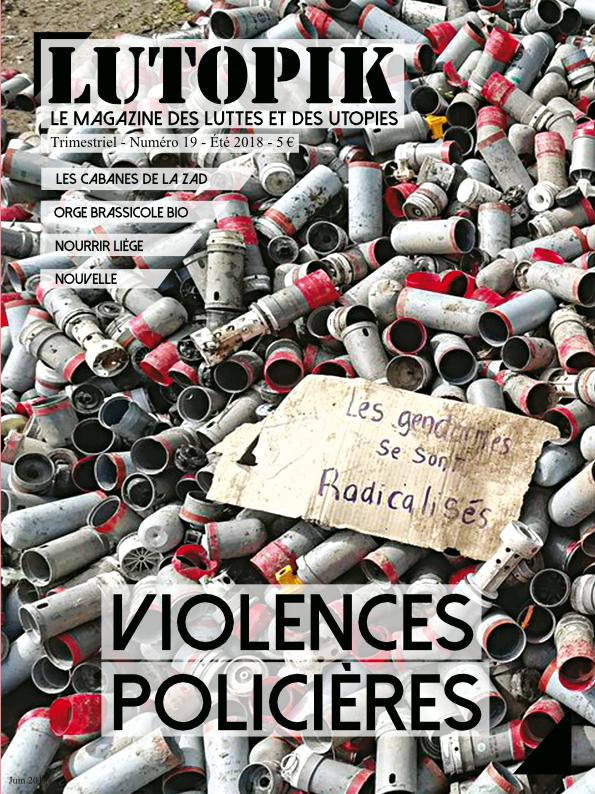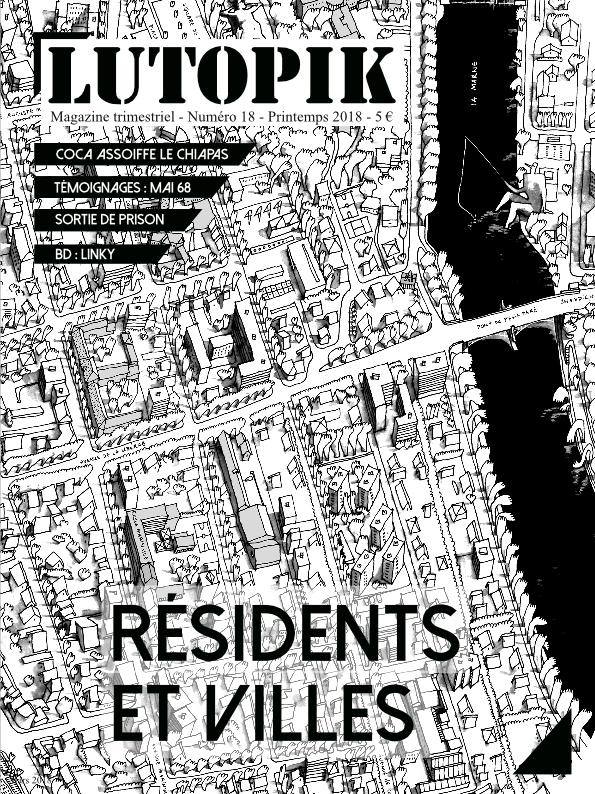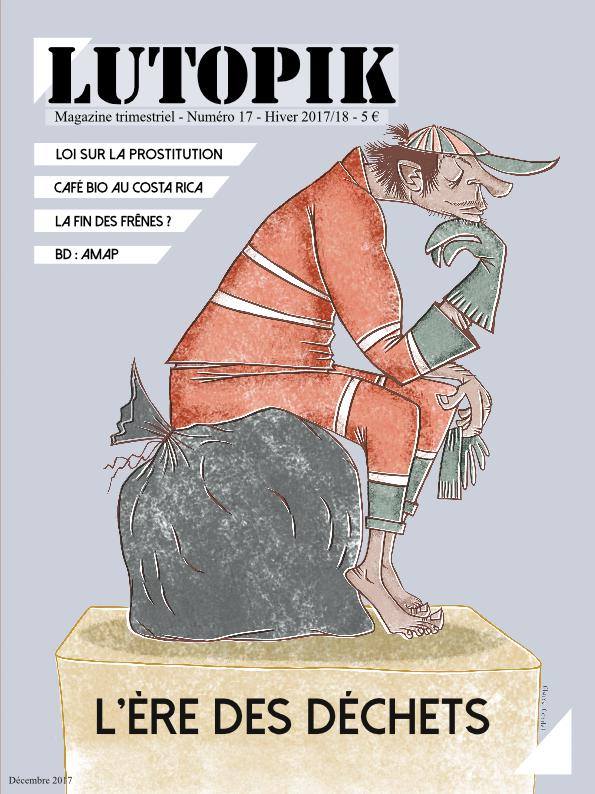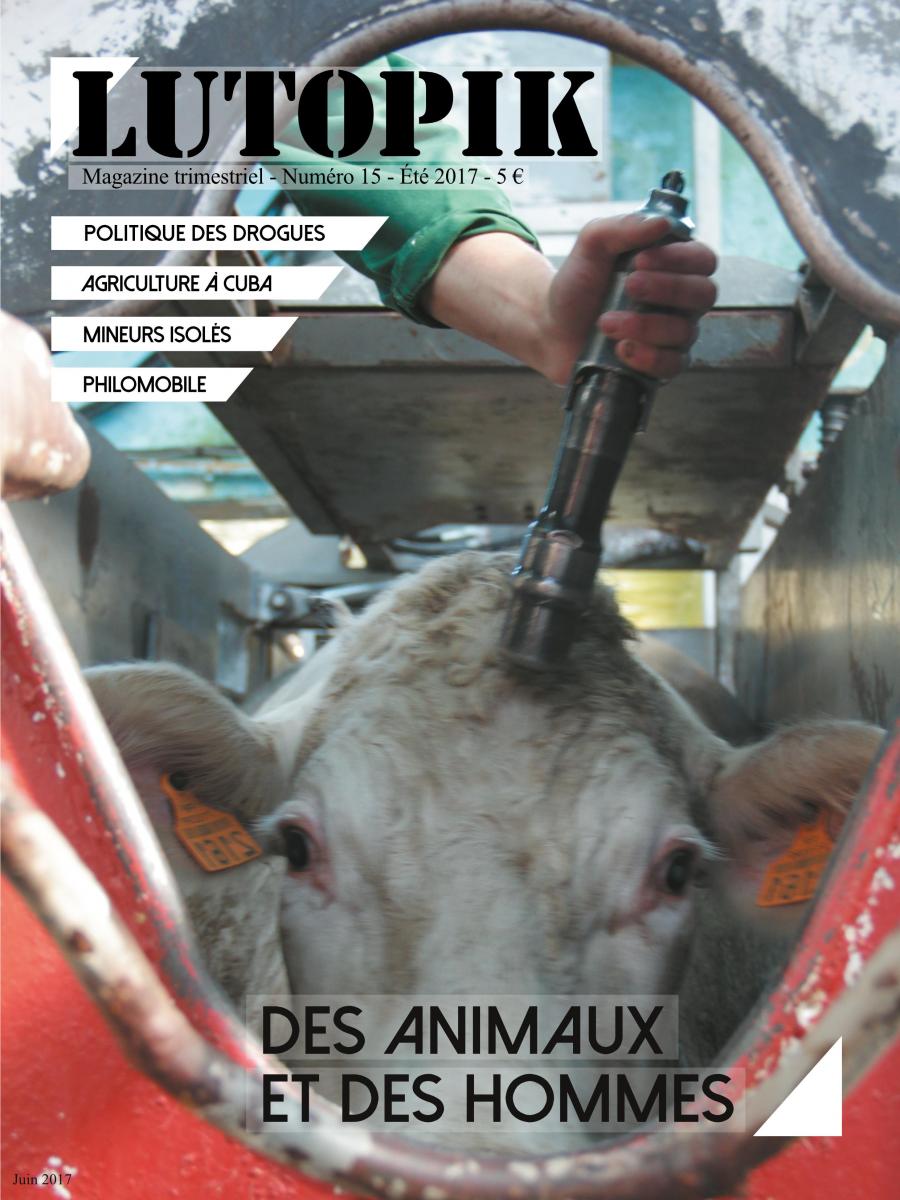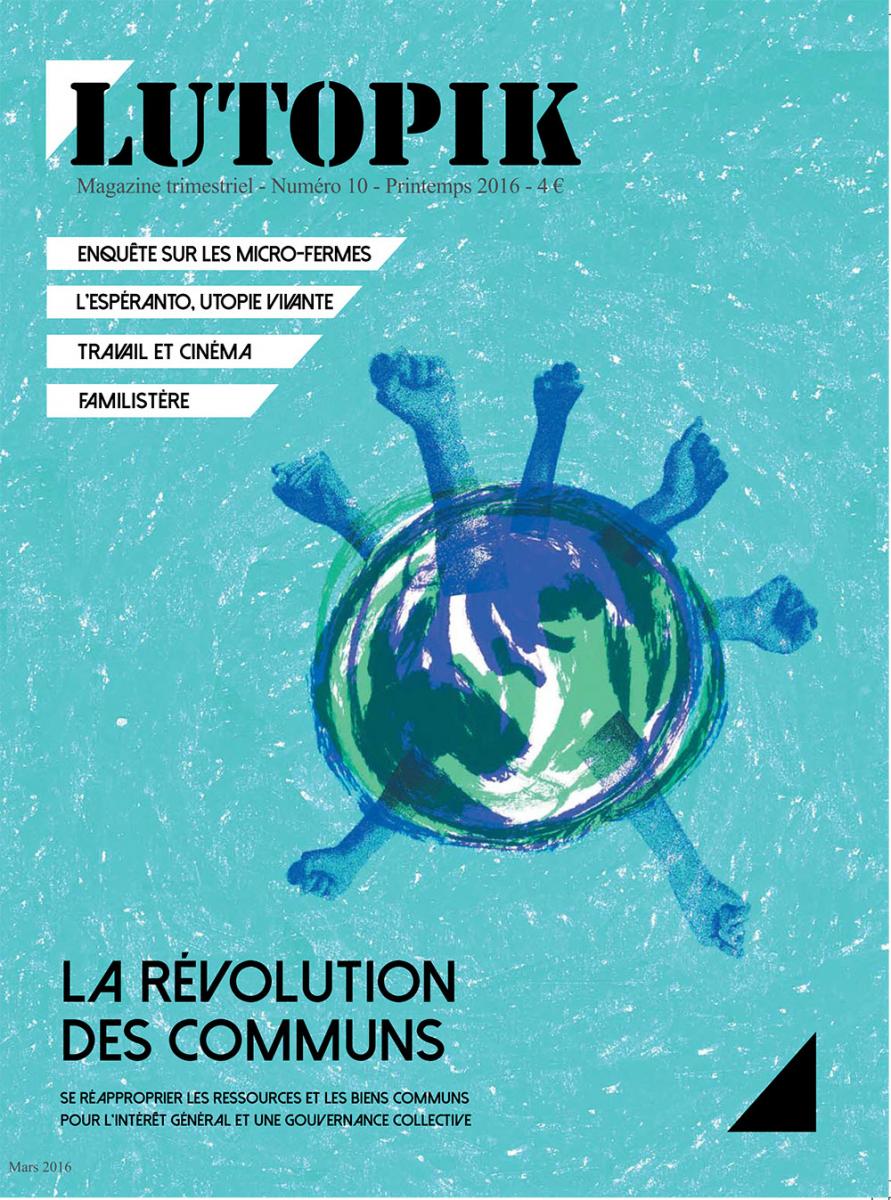"L’ouverture à la concurrence est faite pour ouvrir de nouveaux marchés, pas pour résoudre un dysfonctionnement du service public"
 À la question « Revenir au service public ? », titre du livre dont il est co-auteur avec Olivier Coutard (La documentation française, 2015), Gilles Jeannot répond oui. Directeur de recherche à l’École des Ponts ParisTech, il travaille depuis 30 ans sur les mutations des administrations publiques à travers le travail de leurs agents. Entretien.
À la question « Revenir au service public ? », titre du livre dont il est co-auteur avec Olivier Coutard (La documentation française, 2015), Gilles Jeannot répond oui. Directeur de recherche à l’École des Ponts ParisTech, il travaille depuis 30 ans sur les mutations des administrations publiques à travers le travail de leurs agents. Entretien.
Pour commencer, pourriez-vous définir un service public ?
Disons que c’est la conjonction entre une offre publique et un service dont la nature est publique. C’est ainsi qu’étaient définis implicitement dans l’après-guerre les grands monopoles de l’énergie et des transports.
Mais c’est une question piège, car la mise en cause des services publics a justement été préparée par la réduction de la définition à son second volet : ce serait la prestation (transport, électricité, santé, etc.), qui serait publique. Être transporté d’un endroit à un autre, même si c’est fait par une entreprise privée, est considéré comme l’accomplissement d’un service public. Si on définit le service public par la seule nature de la prestation, on ouvre la voie à la libéralisation.
C’est en particulier la stratégie de la Commission européenne qui, avec les SIEG, les services d’intérêt économique général, s’est efforcée de construire une théorie du service, indépendante de la question du prestataire. Cela permet à partir des années 1990 de rogner la dérogation aux règles de concurrence pour ces services qui était inscrite dans le traité de Rome de 1957.
Tous les secteurs sont-ils condamnés par l’Europe à être ouverts à la concurrence, y compris des secteurs comme la santé, la justice, l’éducation ?
Ce qu’on appelle service public en France recouvre deux notions distinctes qu’il faut différencier. Il y a d’une part les services économiques, qui sont les grands services en réseau : la Poste, le téléphone, l’électricité, les routes, le train, etc. Et puis il y a l’ensemble des activités publiques administratives, régaliennes et autres. L’enjeu propre au service public est plutôt sur la première partie, car les fonctions administratives sont moins directement mises en cause par l’Europe. Par exemple, des fonctions régaliennes comme la justice ou la police ne sont pas considérées comme devant être mises en concurrence.
Mais la santé si…
En effet oui. La mise en cause de la gestion publique s’étend progressivement. Initialement, la mise en cause par la direction de la concurrence a porté sur les services en réseaux comme l’électricité, les transports, la poste. Mais progressivement, les mêmes principes sont appliqués à des composantes de l’offre de services comme la santé ou l’école.
L’expression « services publics à la française » revient souvent. Quelles sont ces spécificités ?
Cette expression est une invention récente. L’expression « services publics à la française » a été inventée par les libéraux pour décrédibiliser le service public tel qu’il existe. Dire « service public à la française », c’est une manière de dire « un service public qui n’existerait qu’en France », et donc évoquer une singularité qui aurait vocation à disparaître. Or, beaucoup de pays ont connu des services publics de ce genre.
En France, il y a deux moments forts dans la construction historique des services publics. Le premier se situe au début du 20e siècle, lorsque de nombreuses communes se mettent à créer des services de transport, mais aussi de boulangerie, de boucherie, de pompes funèbres, etc. On évoque alors le socialisme municipal : une sorte d’État social au niveau des communes. L’État est très inquiet de cette prolifération et cherche à encadrer ces initiatives. Cela fonde le droit de notre service public dans une logique déjà libérale.
La deuxième étape se joue dans les années 30 et jusqu’à l’après-guerre, avec la prise en charge massive par l’État de grands secteurs publics, tels que l’électricité et le train. Il s’agit notamment pour l’État de ne pas avoir un très grand nombre de petites sociétés qui font de l’électricité dans leur coin et de régler le problème des petites compagnies de chemin de fer qui faisaient faillite. Ce sont ces grands services publics nationaux qu’on appelle le service public à la française, c’est-à-dire cette conception d’un service public offert par l’État de manière très intégrée, à la fois pour des raisons techniques et politiques.
Cette conception intégrée d’une offre publique de services publics, propre à la deuxième étape, se retrouve dans des formes différentes dans la plupart des pays européens. Les Suédois ont par exemple eux aussi une offre de services très large, encore plus large que la nôtre, sorte d’extension de leur État providence. Les Italiens ont eu des politiques économiques générales qui recouvraient ces services. Les Allemands ont un système très particulier, les Stadtwerke, qui sont des grandes entreprises municipales multiservices intégrées. Et même en Grande-Bretagne il y avait des services très intégrés publics, dont le NHS (National Health Service) reste le dernier fleuron.
Quelle est la différence entre étatisation et nationalisation ?
C’est un vieux débat qui remonte aux années 30. On avait par exemple cinq ou six grandes entreprises ferroviaires. Nationaliser, ce n’était pas seulement les rendre publiques, c’était aussi en créer une seule qui soit de niveau national. Avec toujours cette idée qu’il y a des gains de productivité liés au réseau. D’une certaine manière, on a le choix entre l’intégration publique pour profiter de ces gains de productivité et les redistribuer à la fois aux destinataires et aussi aux agents, ou être dans la situation du privé avec toujours le risque d’un monopole et d’un abus de monopole.
Pourquoi faudrait-il sauver le service public ?
Parce que l’offre publique de ces services publics permet de capitaliser collectivement les gains associés au monopole. Cela permet des péréquations entre parties non rentables et rentables (par type de territoire et de population) sans créer des compensations sociales progressivement rognées. Cela permet aussi de maintenir sur tout le territoire des conditions d’emploi et de travail décentes pour des agents publics attachés à la qualité des prestations dans les interactions quotidiennes avec les usagers.
Y a-t-il eu une place un jour pour les usagers dans la gestion des services publics ?
Il y avait dans l’après-guerre une tentative de gestion à trois : État, syndicats, usagers. Mais en fait, les usagers ont toujours été relativement marginaux dans la gestion de ces grandes entreprises publiques.
Aujourd’hui, ils y sont encore moins parce qu’on est dans un modèle de concurrence et d’« exit » plutôt que de « voice » : vous n’êtes pas contents, vous changez d’opérateur plutôt que de râler. Ça ne veut pas dire que les gens sont tous ravis de ce modèle : certains ont l’impression, qui n’est pas complètement infondée, qu’ils se font toujours avoir. Avant, le jeu était inégalitaire, mais d’une certaine manière, c’était clair : on savait qu’on n’avait pas son mot à dire. Maintenant on dit « c’est vous qui choisissez votre opérateur », sauf que ce n’est pas nous qui rédigeons les contrats. On est toujours dans une position dominée.
Si on regarde par exemple le cas de l’électricité, où les gens sont très réticents à quitter l’opérateur historique, on s’aperçoit que parmi ceux qui changent, il y a souvent des cas qui s’apparentent à de la vente forcée. Une enquête faite en Grande-Bretagne montrait que les gens qui avaient changé d’opérateur étaient souvent ceux qui n’avaient pas de digicode et donc chez qui les démarcheurs pouvaient aller et vendre des contrats de manière un petit peu abusive, sans d’ailleurs qu’ils aient toujours compris ce qu’il se passait. L’enquête montrait que souvent le changement d’opérateur se traduisait par une augmentation des factures.
La téléphonie mobile est l’un des seuls secteurs où les prix ont baissé après l’ouverture à la concurrence. Comment expliquer que l’ouverture à la concurrence fait parfois baisser ou monter les prix, ou la plupart du temps ne change rien ?
Sur la téléphonie, ça n’a pas grand sens de comparer le service en 1990 et en 2020. La pratique du téléphone n’est plus la même, et ce n’est pas l’ouverture à la concurrence qui en est la cause. Les évolutions sont d’abord technologiques. Et d’ailleurs, pour un ménage avec deux enfants qu’il faut équiper par un portable, plus l’internet, etc., le budget global téléphonie n’a pas tant baissé que ça.
Sur l’électricité ou le gaz, où c’est plus comparable, une étude de Massimo Florio montre qu’il n’y a pas de changement significatif des prix lié à la concurrence pour l’électricité et une légère augmentation pour le gaz. L’enjeu des prix, souvent mis en avant, n’est pas essentiel. Cette situation s’explique en particulier par le fait que par leur « nature », ces services sont associés à des monopoles.
Quels sont alors les avantages de l’ouverture à la concurrence ?
L’ouverture à la concurrence n’a pas été engagée parce que les réseaux ne marchaient pas. Elle est faite pour ouvrir de nouveaux marchés, pour ouvrir de nouvelles opportunités aux entreprises. La finalité n’est pas de résoudre un problème de dysfonctionnement des services publics.
L’État peut perdre de l’argent. Le cas le plus flagrant est celui des autoroutes. Celles-ci permettaient aisément de faire rentrer de l’argent dans la caisse de l’État. Les sociétés privées d’autoroute (gérées de manière semi-publique) ont gagné plus que ce qu’elles ont racheté à l’État. L’État gagne de l’argent une fois en vendant au privé, mais il perd la possibilité d’en gagner avec des services. La téléphonie était aussi quelque chose qui rapportait à l’État avant d’être ouverte à la concurrence.
Dans une logique d’économies de ressources, notamment d’eau ou d’énergie, la privatisation peut-elle continuer ? Quelle société privée encouragerait sa propre perte en prônant des économies de consommations ?
La question intéressante est celle des choix modaux. Sur le transport, le ferroviaire est plus vertueux que le transport par bus. Mais il semble que l’ouverture à la concurrence favorise plutôt une désintégration de l’offre et fait apparaître que le bus est plus rentable économiquement. C’est vrai pour beaucoup de petites lignes donc ça veut dire qu’on va remettre plus de bus que de trains.
Quant à diminuer les consommations… sur l’eau c’est un problème un peu particulier. À Paris le gros problème c’est que la consommation baisse et que le coût de l’entretien du réseau est toujours le même. Donc le prix au m³ va augmenter. La baisse de la quantité d’eau ne me semble pas un enjeu important. Ce qui l’est plus, c’est l’intégration complète du cycle de l’eau, de sa production à son retraitement. C’était d’ailleurs l’un des enjeux de la ville de Paris lorsqu’elle a remunicipalisé ce secteur. Mais comme Paris est isolé, et les villes autour sont tenues en délégation par des compagnies privées, cela ne facilite pas l’intégration au niveau de l’agglomération.
Est-ce que la question reste valable sur le secteur de l’énergie, où l’objectif est de diminuer de 20 % d’ici 2020 la consommation énergétique. Comment un opérateur privé peut encourager ce mouvement ?
Là aussi, la moindre consommation d’électricité est moins liée à l’influence de l’opérateur qu’à des investissements comme l’isolation de sa maison. C’est le rôle des pouvoirs publics d’inciter à ces investissements.
Vous citiez Paris qui a remunicipalisé sa gestion de l’eau. Est-ce que c’est un exemple qui fait tâche d’huile ?
Au niveau européen, on observe un petit mouvement de remunicipalisations. En Italie, Berlusconi a rendu quasi obligatoire l’ouverture au privé des réseaux d’eau. Ce projet de loi a été cassé après un grand mouvement qui s’est traduit par un référendum et un certain nombre de villes ont redéveloppé des services municipaux. En Allemagne plusieurs villes, dont Berlin et Hanovre, réinvestissent les domaines de l’eau et de l’énergie avec une logique écologique. Et à un niveau plus collectif, les villes allemandes ont aussi collectivement négocié avec force pour la défense du niveau municipal et en particulier pour les droits des entreprises municipales de faire des prestations externes à hauteur de 20 % de leur chiffre d’affaires, condition pour leur équilibre économique.
En France, pour le secteur de l’eau, l’équilibre entre la régie et la délégation à des entreprises privées a peu été modifié. L’un des arguments intéressants est que l’existence d’une offre publique sert à éviter les dérives de l’offre privée. Quasiment tous les gens qui ont travaillé sur le prix de l’eau constatent que l’on n’a pas de différence entre la régie et le privé. Or en régie, les coûts de production sont par nature un peu plus élevés, notamment avec le statut de la fonction publique, qui offre une plus grande protection aux salariés. La différence se retrouve dans les bénéfices des sociétés privées. Et donc tant qu’il y a une offre crédible en régie municipale, le privé ne peut pas trop grossir ses bénéfices. Ils sont un peu obligés de s’aligner sur le prix du public.
Le statut des opérateurs publics, notamment des cheminots, est remis en cause. Quelles seront leurs garanties à l’avenir ?
Cela va être l’enjeu de la suite des discussions. Après le statut public, il y aura les conventions collectives. Dans le domaine de l’énergie ou de l’eau par exemple, elles sont très proches du statut public. De plus, quand vous passez d’une régie à un service privé, vous devez reprendre les mêmes agents. Pour les TER (trains express régionaux) par exemple, qui dépendent des régions, ces dernières pourront contractualiser avec la Deutsche Bahn ou avec Veolia pour faire du train, plutôt qu’avec la SNCF. Dans ce cas, Veolia reprendra les agents de la SNCF, et il les reprendra dans le cadre d’une convention collective. L’enjeu très important aujourd’hui c’est que cette convention collective ne soit pas fortement différente du statut.
Et sur d’autres secteurs, comme La Poste...
Le cas de La Poste pose une question plus radicale : celle de l’uberisation : une mère de famille sans emploi dans le périurbain peut travailler deux heures par jour pour distribuer le courrier en étant auto-entrepreneuse à la demande d’un opérateur qui créerait une offre complètement indépendante. Là, la dégradation des conditions d’emploi est plus radicale.
Il y a quelques années, La Poste a misé sur des gains de productivité dans l’infrastructure pour pouvoir résister à la concurrence de cette forme d’emploi. Elle a beaucoup investi dans des centres de tri automatiques qui permettaient de gagner sur l’efficacité du réseau, plutôt que d’uberiser le service comme le faisait au même moment son homologue néerlandaise. Cet organisme essaye aujourd’hui d’enrichir les tâches de ses salariés avec des programmes comme « accompagner mes parents ». Mais cette posture reste fragile face à la concurrence.
Vous travaillez actuellement sur l’impact du numérique sur le service public...
Je m’intéresse notamment à la question de l’évolution des services publics face aux nouveaux effets du numérique. Cela pose un défi nouveau : celui de la confiance. Les grandes entreprises publiques avaient su créer une forte confiance, jamais atteinte par les entreprises privées, à partir de la fiabilité technique et de la présence territoriale. Les nouvelles offres des plateformes numériques génèrent d’autres formes de confiance liées à l’inter-notation des utilisateurs, comme dans Blablacar. Le public doit apprendre à trouver sa place dans ce nouveau contexte.
Propos recueillis par Sonia